PREMIÈRE DIFFUSION : 19 JUILLET 2015
Portraits des anonymes
Fuyant des conflits, errant à travers les nations, ou misant sur un meilleur avenir… le portrait type de ces jeunes serait fastidieux à dresser. Et les chiffres, pour les cerner, sont insuffisants. En résumé : ils avaient en moyenne 16 ans (et deux mois) quand ils sont arrivés en France. Ils ? Beaucoup de garçons (87%) et de nombreuses nationalités : 69 pays étaient concernés en 2014. Au peloton de tête, les Maliens (34% des arrivants), puis les Égyptiens (9%), Guinéens (8,5%), Afghans (7%) et Bangladais (6%). Et s’il est difficile de mettre un âge sur ces visages creusés, il l’est tout autant complexe de décrypter leur histoire.
Le poids du passé
Nombreux sont ceux qui ne veulent plus livrer leur histoire, et qui ont besoin d’une assistance psychologique (un des engagements que la mairie de Paris a pris début 2015 sous la pression des associations et des médias). Si les histoires sont multiples, la sociologue Angélina Etiemble a essayé de définir les différents causes de départ… une typologie en sept temps :
- Les exilés (fuyant la guerre ou l’exploitation, le plus souvent demandeurs d’asile)
- Les mandatés (envoyés par les familles pour l’école ou pour trouver un travail)
- Les exploités (victimes des réseaux de prostitution, de mendicité, d’activités illégales…)
- Les fugueurs (le plus souvent originaires du Maghreb et d’Europe orientale)
- Les errants (mineurs généralement sans domicile fixe dans leurs pays d’origine et passant de frontières en frontières)
- Les « rejoignant » * (dont les familles, ou le point de chute, ont fait défaut à l’arrivée en France)
- Les aspirants * (à la recherche de meilleures conditions de vie, très politisés)
*distinctions rajoutées en 2013 après un nouveau travail réalisé avec Omar Zanna, docteur en sociologie et en psychologie.
Leur prise en charge
La loi du 5 mars 2007 relative à la protection de l’enfance a rappelé que l’État français considère tout mineur étranger privé de la protection de sa famille comme en danger, et donc, à prendre en charge par l’ASE (Aide Sociale à l’Enfance).
Cette prise en charge coûte près de 50 000 euros par an par mineur à l’ASE (qui disposait en 2014 d’un budget de 369 millions d’euros), mais il s’agit d’une moyenne car elle varie d’un individu à l’autre, selon le type de prise en charge (contrat jeune majeur, type d’hébergement…). En 2013, au vu du nombre grandissant d’arrivées sur la capitale, première destination des jeunes (plus de 300 mineurs en plus en un an), et de la charge conséquente représentée pour le département, une circulaire (circulaire Taubira du 31 mai 2013) a été publiée afin de répartir la prise en charge. Fin 2014, le bilan faisait état de 6158 MIE pris en charge sur le territoire français. Parmi eux, 37% avaient été orientés vers d’autres départements.
Les tests d’âge osseux
Quand ils ont pu préserver leurs papiers du périple vers l’Europe mais qu’ils sont quand même mis à l’épreuve, ou quand les radiographies de leur squelette* les font mentir, ils se trouve plongés dans une zone de non-droit : le “Ni-Ni” de la clandestinité. Ni mineurs, ni majeur, on ne les croit pas sur papier, mais on ne leur donne pas d’âge non plus.
Alors que cette absence de statut leur complique immensément l’accès à la solidarité, à la demande d’asile, aux papiers… au logement, au travail… et la liste continue, elle fait également grossir le rang de leurs ennuis. Ainsi, les MIE peuvent écoper de quatre lettre supplémentaires, OQTF, pour obligation de quitter le territoire français, ou encore être poursuivis pour faux et usage de faux. Après l’espoir, la case prison.
* Pratique basée sur un Atlas de 1930 réalisé d’après des populations aisées, blanches et américaines.
Journaliste : Naomi Roth
Images : Hélène Corbie, Flore Viénot, Julie Dubois
Montage : Antoine Conort
Des liens
- Un article du Gisti (l’association qui a présenté Ali, le jeune isolés étranger de notre reportage, aux tests du CASNAV ayant abouti à sa scolarisation)
- Le réseau Européen des migrants sur le site du Ministère de l’intérieur
- Un autre lien utile vers le ministère de l’Intérieur (Etudes du REM : Politiques, pratiques et données statistiques sur les mineurs isolés étrangers en 2014).
- Les mesures de la Mairie de Paris.
- La Circulaire Taubira
- La question du faux et usage de faux sur Legifrance

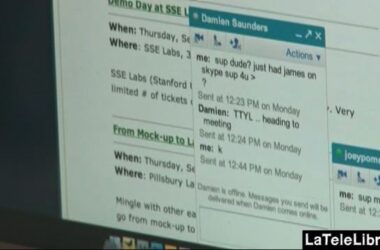


Commentaires
Sujet très intéressant. D’autant que ce genre de thématique n’est retenu dans le débat publique que par l'incidence de son coût direct sur les finances publiques. Mais c’est pourtant oublier facilement les conséquences humanitaires indirectes bien plus onéreuses pour une société qui se prévaut comme ultime défenseur des Droits de l’Homme. Et le sujet des MIE (mineurs isolés étrangers) n’étant alors pas sans rappeler le débat sur l’AME (aide médicale d’Etat). D’ailleurs, la circulaire de 2013 « relative aux modalités de prise en charge des jeunes isolés étrangers » avait déjà en son temps subit les réprimandes appuyées et étayées de la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH). On n’y parle rien de moins que de nombreuses carences et de la nécessité d’assurer la pleine effectivité des droits des mineurs présents sur le sol français. http://www.cncdh.fr/sites/default/files/14.06.26_avis_situation_des_mie_0.pdf La CNCDH y rappelle l’intérêt supérieur de l’enfant alors que ce dernier cumule les tares d’être considéré comme avant tout étranger, en plus que d’être mineur et isolé. Ces mineurs sont estimés à environ 9 000 sur le territoire et ont tous droit à une protection et une aide spéciale de l’État. Malgré un dispositif actuel de prise en charge (mise à l’abri, évaluation de l’âge et orientation), le bilan dressé par la CNCDH est donc sans appel : il existe « de nombreux dysfonctionnements » et les pouvoirs publics doivent se porter garants des « droits non pas théoriques et illusoires mais concrets et effectifs » au profit des MIE présents sur le territoire français. La plus grande difficulté concernant le statut des MIE repose sur l’évaluation de leur âge, la minorité conditionnant le bénéfice de la protection par l’aide sociale à l’enfance (ASE). Et les méthodes de détermination de l’âge des MIE, en particulier le recours aux tests médicaux (osseux surtout mais aussi pileux, dentaires ou génitaux) sont mis à l’index. D’autant que ces mesures doivent être utilisées « si le doute persiste au terme de l’étape de vérifications [des papiers administratifs d’état civil…], et seulement dans ce cas, il peut être procédé à une expertise médicale sur réquisition du parquet ». Mais en pratique, la Commission s’indigne du détournement de ces tests médicaux et de l’« utilisation abusive » du recours aux tests osseux consistant à faire subir aux MIE de multiples expertises jusqu’à ce que l’une d’entre elles conclue finalement à leur majorité ! Et est reprochée une instrumentalisation des tests permettant de facto « de réguler l’accueil des MIE en fonction du nombre de place libres dans les services dépendant de l’ASE ». Pour ajouter une difficulté dans le parcours de légitimité de minorité de l'enfant, le département dans lequel le mineur a été orienté peut procéder à un nouveau test afin d’établir sa majorité et aboutir au prononcé d’un non-lieu à assistance éducative, aussi de l’absence de consentement du MIE aux actes médicaux (un refus pouvant entrainer abusivement une présomption de majorité). Bref, une systématisation pourtant considérée comme une solution d’ultime recours. Surtout que la fiabilité de ces mesures portent à suspicion : elles sont fondées sur la méthode de Greulich et Pyle qui vise à comparer les radiographies des os des MIE à un atlas élaboré en 1935, répertoriant des radiographies de jeunes européens. D’où des marges d’erreurs importantes (de 2 à 3 ans). Et la CNCDH de conclure en « recommandant fermement l’interdiction pure et simple du test osseux », « qu’il soit mis fin à tout examen physique pour déterminer la minorité ou la majorité d’un jeune isolé étranger » et « la détermination de l’âge ne doit en aucun cas être établie à partir d’un examen osseux, des parties génitales, du système pileux et/ou de la dentition ». Légalement, les « autorités françaises ont pour obligation d’accomplir loyalement toutes les diligences et démarches nécessaires pour récupérer des éléments de l’état civil auprès des autorités de l’État d’origine du jeune ». Et, vérification de l’acte d'état civil étranger faite, c’est à l’administration d’apporter la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme du papier civil présenté par le MIE. Aujourd’hui encore, un simple « doute » sur la validité des actes présentés par le jeune étranger suffit à autoriser le recours aux examens médico-légaux. Dans sa critique détaillée, la CNCDH déplore également le manque d’information du MIE en amont, lorsqu’il rentre en contact avec les services d’accueil (communication dans une langue qu’il maitrise, droit à l’assistance d’un interprète, d’un avocat, bénéficie de l’aide juridictionnelle etc.). Ces observations dressées par la Commission nationale sont importantes dans un contexte où les MIE sont souvent dans une précarité d’hébergement, dans situation sanitaire particulièrement vulnérable. A ces situations à gérer par les services publiques, vient immanquablement le contre argument de la charge financière que font peser les MIE sur les services de l’ASE. Il faut savoir que sur les 275 000 jeunes pris en charges en 2011, seuls 4 000 à 8 000 d’entre eux (moins de 3 % !) étaient considérés comme MIE. Et le mécanisme consistant à assurer une prise en charge de ces jeunes mineurs et à rejeter parallèlement toute protection post-majorité de ces mêmes jeunes témoigne d’une logique de gestion précaire de la minorité. Or, en l’absence de toute continuité de l’assistance, les investissements sont nécessairement infructueux puisque passés la minorité, les MIE redeviendront pour la plupart avant tout étrangers... L'échec de la mesure n'en sera que plus aisée à souligner !?