MÉDIA-MALAISE
Deux mois après sa diffusion sur Arte, le film « la Cité du Mâle », dérange toujours
C’est ce documentaire qui avait été déprogrammé les 31 août dernier, suite à des menaces qui auraient été tenues contre une des journalistes ayant préparé le film. Après le floutage de certains visages, le doc sera quand même diffusé, un mois plus tard sur Arte, ainsi que la Théma « Femmes, pourquoi tant de haine? ».

Ce Jeudi 18 novembre, nous nous sommes rendus à Vitry-sur Seine – cadre de ce documentaire qui entendait traiter des rapports hommes-femmes dans certaines banlieues dites sensibles – pour assister à un débat sur le doc entre des jeunes de la ville et leurs professeurs. Le sujet de Cathy Sanchez, irrite pour son supposé parti-pris. Et soulève un éternel débat : qu’en est-il de la représentation des cités et du regard des journalistes dans leur façon de traiter les maux de certaines banlieues ?

« Le documentaire généralise sur la banlieue. Je connais beaucoup de personnes qui ne pensent pas comme ça dans les cités. Où sont-elles dans le reportage? Et on parle de territoires. On est en France. Il n’y a pas de territoires ».
Le débat, qui se tient dans une salle associative au pied d’un grand ensemble, est lancé par Mohamed. Son avis semble partagé par d’autres lycéens. Dans le collimateur des jeunes Vitriots, la voix off du documentaire qui étend parfois ses analyses à l’ensemble des banlieusards. Mais aussi le choix des protagonistes de la « Cité du Mâle », composés principalement de jeunes qui tiennent les murs et portent un même discours machiste sur les femmes. Celles-ci doivent être «pures» et filer droit sous peine de devenir des parias au sein de leur propre quartier. Un casting uniforme – se voulant représentatif de la mentalité des jeunes en cité – qui irrite Michelle Gerci, journaliste et intervenante à l’école de journalisme de Paris : « Il n’y a aucune honnêteté journalistique dans ce travail. On ne retrouve qu’un type de personnes interrogées. On ne voit aucun croisement des sources. Ce film est un appel à se mobiliser contre les banlieues ». Sur ses cinquante deux minutes, « La cité du Mâle » ne comporte en effet qu’un seul témoignage positif. Issa, trentenaire employé de mairie, pousse un vibrant appel au respect des femmes à la fin du documentaire.

Certains jeunes instrumentalisés ?
Ce constat mis à part, des doutes subsistent sur la manière dont Cathy Sanchez a mené son documentaire. Le 31 août dernier, Nabila Laïb – journaliste qui a servi de passerelle entre l’équipe de tournage et les habitants de Vitry – exigeait la déprogrammation du reportage auprès d’Arte. Elle reprochait notamment à Cathy Sanchez d’avoir trié ses témoignages au service d’un message qu’elle voulait faire passer. Ladji Real – jeune réalisateur qui mène actuellement un contre reportage sur « la Cité du Mâle » – était présent jeudi soir. Si les résultats de son enquête ne captivent pas outre mesure les organisateurs du débat – qui le prient gentiment de ne pas filmer – ses révélations en off surprennent : « Les jeunes [interrogés] estiment que leurs propos ont été sortis de leur contexte au montage. Ou qu’on leur a dit que ce n’était pas filmé. Certains disent même qu’ils étaient fatigués et qu’on leur a dit de dire « ça ». Au final, les propos retranscrits sont des propos qu’ils n’assument pas du tout. » Cathy Sanchez, que nous avons tenté de joindre par le biais de Doc-en-Stock, la boîte de production qui a produit le film pour Arte, n’a pas pu – ou voulu – s’exprimer sur la polémique. Notre interlocutrice chez Doc-en-Stock, nous a concédé que la réalisatrice, très affectée par les critiques négatives dont elle fait l’objet, préférait ne plus rentrer dans le débat, « car les critiques sur le film sont idéologiques ». Le mot de la fin revient donc à Ladji : « Après, c’est la parole des jeunes contre celle de Cathy Sanchez ».
Le regard des journalistes mise en cause
Le malaise suscité par « La Cité du Mâle » soulève par ailleurs un éternel débat. Cette fois, la profession journalistique entière se voit visée. « Qu’en est-il de son objectivité sur les maux de certaines banlieues ? », Odile Marquant, professeur d’économie à Vitry et membre de reporter sans frontière, avance une explication. Selon elle, le malaise actuel résulterait du fossé sociologique entre les journalistes et les jeunes de cité : « Il y a très souvent une telle différence de milieux entre les deux parties qu’il n’y a aucune connaissance sur le sujet traité. Les journalistes arrivent de milieux complètement différents. Et ont une vision souvent fantasmée et fausse de la banlieue ». Un ouvrage du sociologue Erik Neveu, Sociologie du journalisme, apporte quelques indices intéressants sur le sujet. Par exemple, sur les quatre écoles de journalisme les plus cotées en France (ESJ-CFJ-CUEJ-IPJ), plus de 70 % des étudiants ont un père cadre ou issu de professions intellectuelles supérieures. Ce fait résulte notamment des droits d’inscriptions élevés (3500 à 7000 euros l’année pour ces écoles). Erik Neveu – joint au téléphone – nous confirme que ce fossé sociologique avec les jeunes de cité influe sur le traitement de l’information : « Le fossé date. Dans les années 1980, lors des premières émeutes de Vaulx-en-Velin, une équipe d’une grande chaîne avait été dépêchée avec la consigne suivante : il nous faut un black, un beur et un dealer. Les jeunes en viennent maintenant à jouer le rôle qu’on attend d’eux. Ce qui génère un jeux de rôle assez pervers ».
Pour une démocratisation de la profession ?
Retour au débat. La soirée s’essouffle et les derniers participants prolongent la discussion dans le hall jouxtant la salle associative. Pour certains de nos interlocuteurs, la solution aux incompréhensions actuelles passerait par une démocratisation des études journalistiques.
Si les formations restent pour la plupart privées – et donc onéreuses – plusieurs initiatives apparaissent ces dernières années, comme la formation Reporter-citoyen, portée par LaTéléLibre et l’EMI. Depuis 2007, le CFJ, gratin des écoles parisiennes, propose à ses étudiants une formation gratuite en alternance décernant un diplôme reconnu. Michelle Martin, attachée de direction au CFJ, assure que cette initiative a permis a l’école d’accueillir de nouveaux profils : « Pour l’apprentissage, on privilégie les étudiants boursiers. L’alternance nous permet d’accueillir des profils différents, qui n’aurait pas accès en temps normal à nos formations ». Selon Erik Neveu, cette prise de conscience des formateurs est réelle mais encore poussive. Notre interlocuteur considère également que ces mesures de démocratisation doivent se combiner à un changement des mentalités au sein même de la profession : « Ce serait bien d’avoir des journalistes issus de l’immigration et des milieux populaires. Cela apporterait une meilleure compréhension de la banlieue. Encore faut-il qu’ils ne soient pas considérés par la rédaction comme un corps expéditionnaire spécialisé ». Faut-il se diriger vers la création de brigades spécialisées à certaines banlieues – à l’image de nos forces de police – ou s’entourer simplement de journalistes plus proches de certains milieux sociaux ? Le dosage reste à définir.
Jonathan Bordessoule
LIENS
- La page de « la cité du mâle », sur le site d’Arte
- Un article de fond sur le site @rrêt sur Image
- « La cité du mâle », vu par deux blogueuses, sur le Bondy Blog

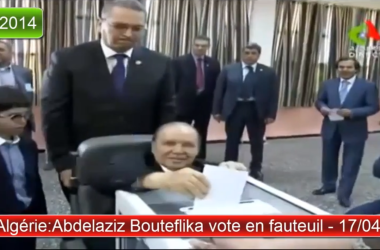
Commentaires
Vers une confirmation du pipeau: http://www.bakchich.tv/La-Cite-du-male-la-contre-enquete.html
Si j'ai bien compris le message de DANY SAVAL (coup d'orchestre!), y faut aussi leur enlever les yeux, à nos capotes-beanies en peau de chien avec quatre pattes ; chatterton conseillé Ds la signature, une copine à Brigitte (et à Caroline ?) -écouter juste les 2:31 à 2:51 pour comprendre qu'est ce que je parle :
Il faut que Caroline Fourest vole au secours des pauvres filles opprimées par les jeunes
Ok, ça marche pas. En signature peut-être...
Diable, je me suis trompé, c'est tout autre chose qu'il faut pour éteindre définitivement les chaudières du stupre! Ca par exemple.
Malheureusement non, Bourreau, et tu n'as que trop raison, c'est par le lucre que notre société s'abâtardit. A défaut de capotes en aluminium j'ai peut-être un remède à cet Etat de Fête. A voir en signature, mais c'est extrêmement risqué.
Oui Trinita, Brigitte ne peux qu'avoir raison, avec sa rhétorique de moulin épileptique ... Rantanplan a gagné ! D'ailleurs, la sourate XVIII alinéa XXX dit bien : "Dieu est le plus grand et Cortex est un con" Mais ça : http://www.youtube.com/watch?v=HwMlELv9FSI&feature=related ? _ Existe t-il des capotes beanies, Aslan, pour ne pas se faire psychotroniquer ?
et puis ça !! http://www.youtube.com/watch?v=s1LwIKW2DX0
sans commentaires ! jugez vous même... http://www.dailymotion.com/video/xfn26s_cortex-clash-pierre-perret-femme-grillage_news
Taliban & Banlieue = Talibanlieusard . Une de leurs armes psychotroniques en signature. Et pour se protéger le bon vieux beanie.
Arrêtes, Bourreau: Banlieue = Cités ; Dans les cités, on écoute que du rap, et il y a plein de méchants pas bien français qui font du mal aux biens français ; Le rap, c'est de la musique de noirs et d'arabes. Donc, d'islamistes. Donc, Brigitte a raison. Et c'est inutile de chipoter: Peu importe que l'Arabie Saoudite soit en Afrique ou non, l'essentiel est que ce sont des arabes. Je pense utile de préciser pour certains que ceci est ironique (sa mère).
Le "nique la France" des rappeurs n'a rien à voir avec l'Islam et l'Arabie Saoudite ne se trouve pas en Afrique.
hé bien c'est pas ce que je vois moi!!!dans le coran ,le rap, il n'y a que des appel a niquer la france,leur religion leur dit qu'on est des mécréants,des dhimmis,et qu'ils doivent nous faire la misére,ils n'aime pas les juif et les chrétiens!!!depuis 600ans ils ont le méssage de nous conquérir,mais ils faut pas aller chez eux!! y a qu'a voir les palestinniens raciste des juifs prêt à les éliminer comme pour la shoa!!! ha s'il pouvaient tous nous détruire et prendre notre pays moderne qu'ils ne sont pas arriver a avoir chez eux!!!regardez Riad tout l'argent du pétrole au lieu de faire des tour de babel des machines à lingot d'or, ils ferraient mieux d'aider leur peuple qui émigre chez nous pour misére,a vivre correctement!!! avec tout ce pétrole l'afrique devraient être comblée sans problème où passe le fric ,comme en france dans les poches des sultants!!!
La cité du mal est un con.
De toute éternité, comme je l'écrirais dans une mauvaise disserte, Arte n'a diffusé massivement que du documentaire complétement main-stream. Voir cette vilaine polémique digne d'un docu-pipeau de TF1 ne me surprend pas, hélas. Sauvons Tracks, Le dessous des cartes, et que reste-t-il de cette chaîne culturelle Franco-Allemande? Je fût encore plus abasourdi quand ils abandonnèrent la VOST, unmöglich! On s'étonnera après ça qu'on ne sois pas capable de collaborer proprement à la prochaine invasion.
@Philippe (et à tous) : à propos de prendre du temps pour mieux établir le contact et comprendre : http://lacourneuve.blog.lemonde.fr/
Bah toi Brigitte, quand tu plains des gens, mieux vaut ne pas en faire partie. "je plains les gens de toutes origines qui vivent en cité,et qui n’ont pas les moyens d’aller ailleur!!! moi je ferais pété toute ses cités!!!!!" D'ailleurs, pesonnellement, je me passe de ta compassion. S'il y a effectivement des gens qui rendent "ma cité" invivable, il n'y a dans leurs actes aucun rapport avec l'Islam.
c'est ce que j'ai vécu dans les cités où j'ai dus partir vite car c'est l'ENFER,les émigrés musulmans,font chasser les autres non musulmans des cités car ils veulent la cité pour eux,pour régner en maitre, ils veulent rester entre eux les autres les déranges,de peur qu'on balance au flic leur trafic et leur braquage ect...ils cassent tout rende la cité invivable et les gens ont peur et se cassent donc les hlm pas cher sont pour les musulmans les autres dehors c'est une honte de se laisser bouffer comme celà par eux,faux pas s'étonner si le fn monte c'est eux les responsables,la cité ne leur suffit plus ils vont priés dans les rues ,burqa,hallal ect....depuis que l'on as receuillis les magrébins et musulmans,ont est flicé de partout,il n'y a aucun problème avec les non musulmans,cette religion a son image rend le peuple arabe fou violent délinquant irrespectueux car le coran les endoctrine de faire la misére au non musulmans!!!je plains les gens de toutes origines qui vivent en cité,et qui n'ont pas les moyens d'aller ailleur!!! moi je ferais pété toute ses cités!!!!!
Un jour, peut-être, un "Qui a peur des banlieusards ?" avec, sans angélisme forcément mensonger, des vrais jeunes-de-banlieue qui ne seraient pas des pantins égoïstes, comme on en montre parfois...
[...] http://latelelibre.fr/index.php/2010/11/%c2%ab-la-cite-du-male-%c2%bb-fait-toujours-mal-aux-vitriots... [...]
"du fossé sociologique entre les journalistes et les jeunes de cité : « Il y a très souvent une telle différence de milieux entre les deux parties qu’il n’y a aucune connaissance sur le sujet traité. Les journalistes arrivent de milieux complètement différents." oui....et pas que sur les problèmes de la cité... et sans animosité ni généralisation démago, et c'est vrai pour tout autre domaine, " s'il y a des mondes dans les mondes " comme disait le sous commandant Marcos, il y a aussi une difficulté immense pour qui que ce soit de comprendre sans prendre le temps, ce qui est l'élément indispensable pour établir un échange sincère, et le temps c'est bien ce qui manque le plus sur la chaîne médiatique qui tourne à toute vitesse ses têtes de gondoles comme le font les grandes surfaces pour appâter le client. Puisque le citoyen y participe de son écran plat et devient avant tout un consommateur y compris de culture à bas prix et d’information en continue, faut fournir et aller à ce qui parait l'essentiel " voilà ce qu'il fallait retenir de l'information" peut on entendre sur une radio entendue dans un car transportant des scolaires ...et pour fournir et répondre à la demande telle que les professionnels de la com l'imaginent , y'a peu de temps, d'argent, faut que çà tourne. si on ne peut pas reprocher à quelqu'un son origine, "t'es un bourgeois, tu comprends rien aux pauvres", c'est vrai et alors? mais c'est plutôt du temps que se donnent les gens pour se comprendre et franchir les barrières nés de nos conditionnements respectifs, et des intérêts contractuels et contradictoires, des égos, qu'autre chose est possible. C'est difficile, parfois explosif, anxiogène et assurément douloureux, mais c'est indispensable. il faut une sacrée dose d'humilité et de capacité d'écoute pour comprendre et ce ne sont pas précisément les valeurs véhiculées par la télé, m^me si un documentaire exceptionnel de sensibilité et de tendresse comme celui de Jean Sébastien Desbordes et Vincent N'Guyen vient heureusement prouver que c'est possible.